L’interview de la semaine 06/11/2024 Fondu au noir : Le …
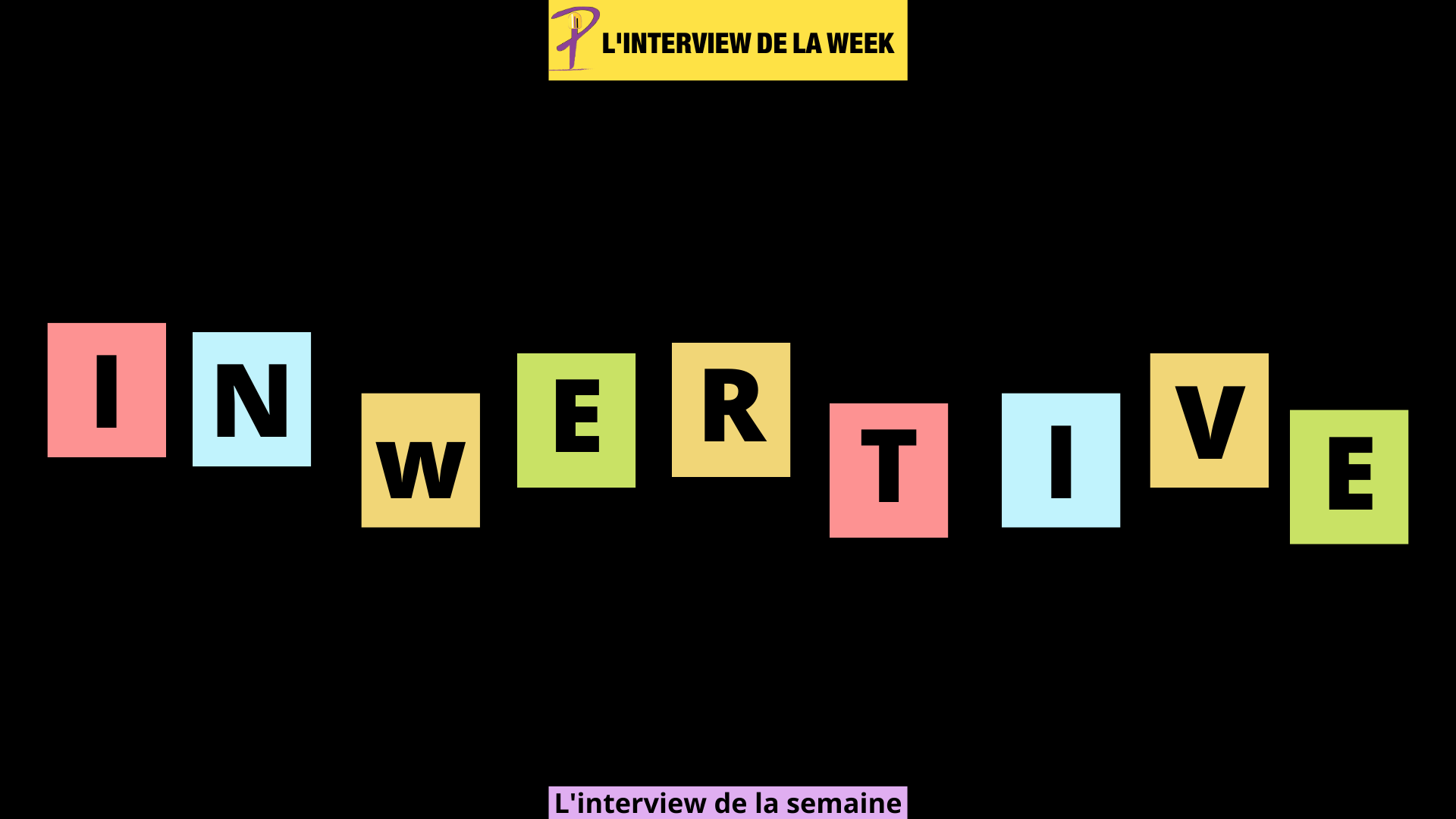
Des interviews, des quiz, des articles sur l'interview et autres thématiques
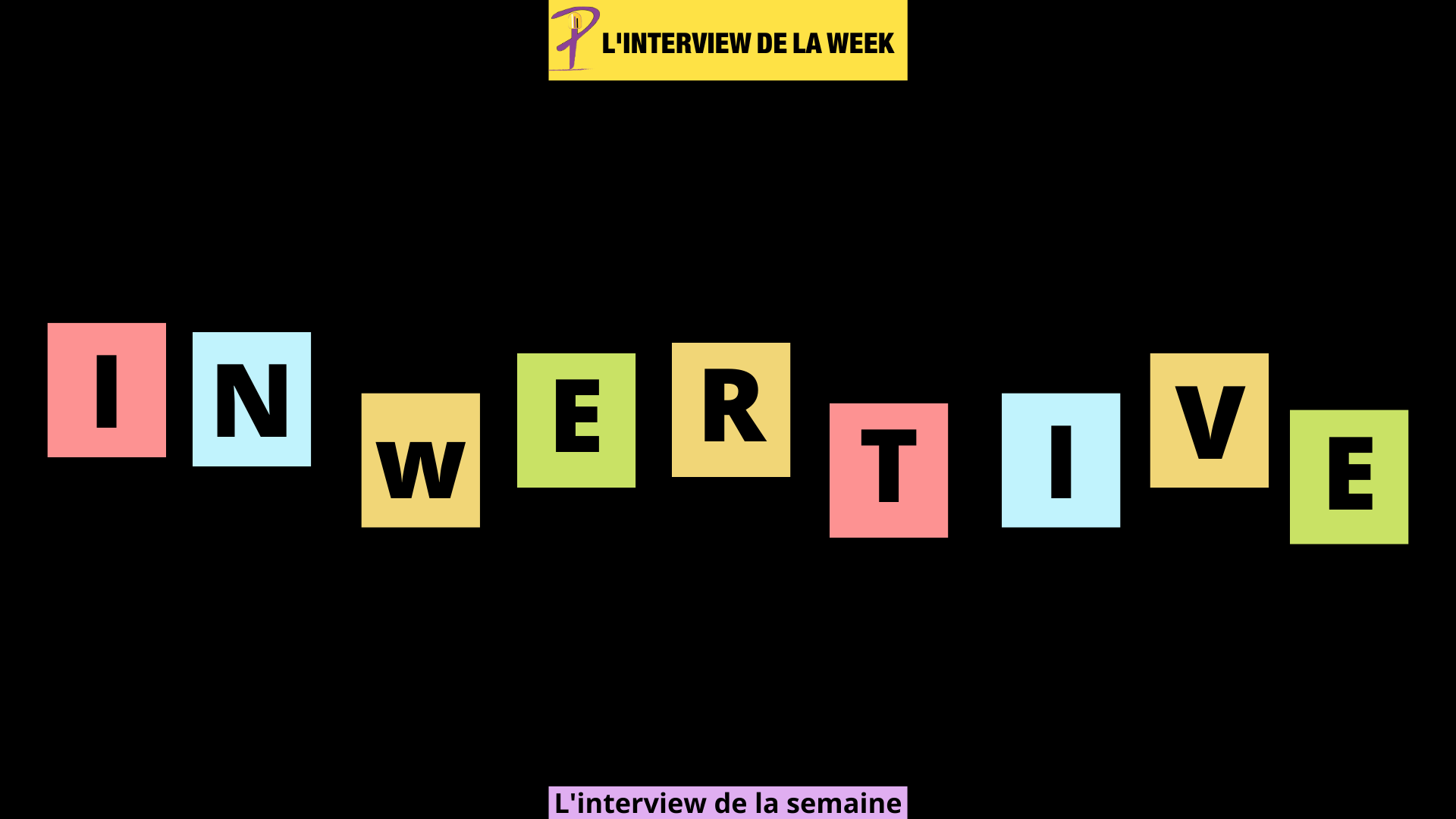
L’interview de la semaine 06/11/2024 Fondu au noir : Le …

L’origine de sa passion 15/03/2021 Une personne passionnée ne peut …
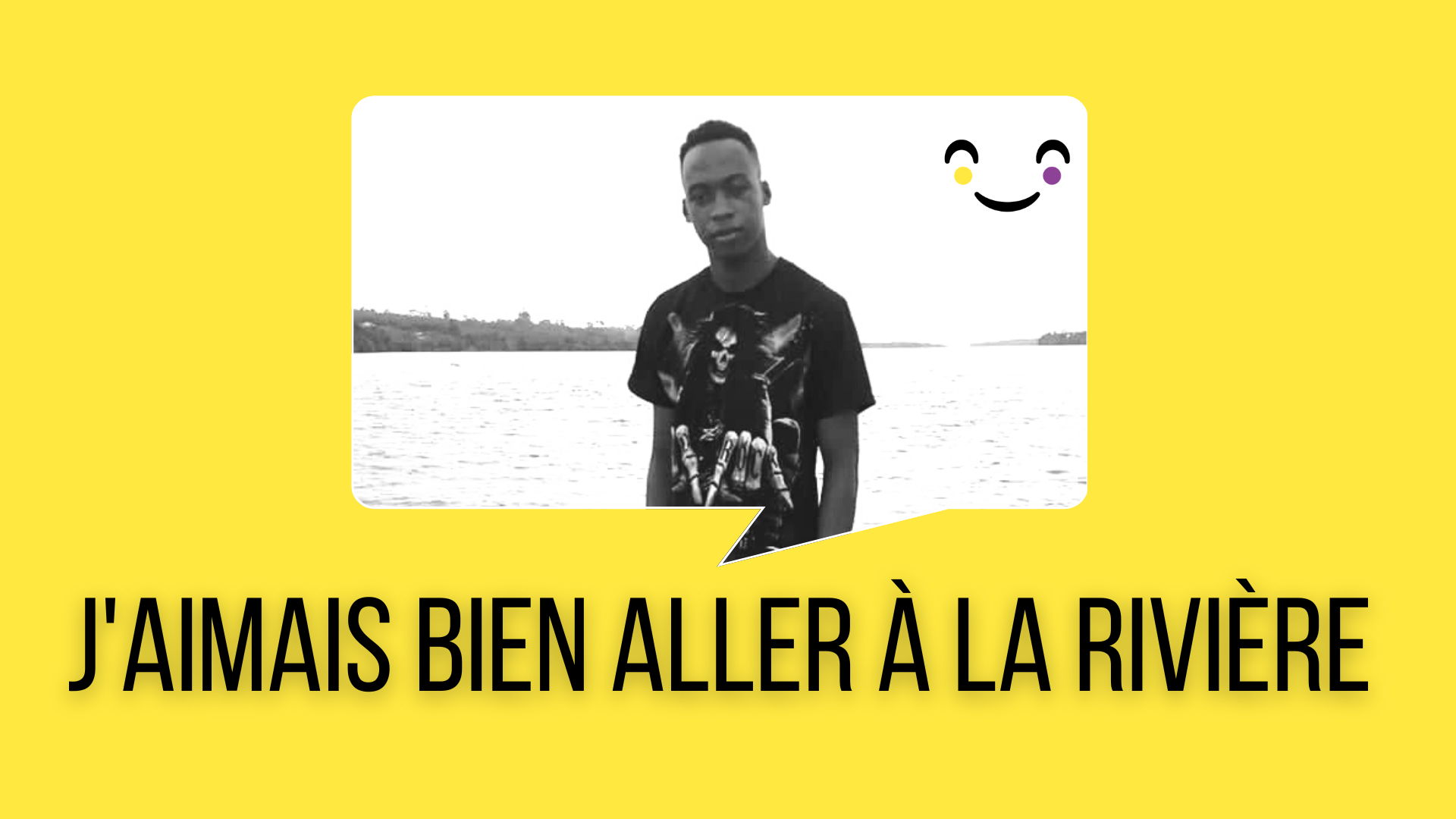

Plantation de cacaoyers 11/06/2019 J’ai commencé à planter mon premier …
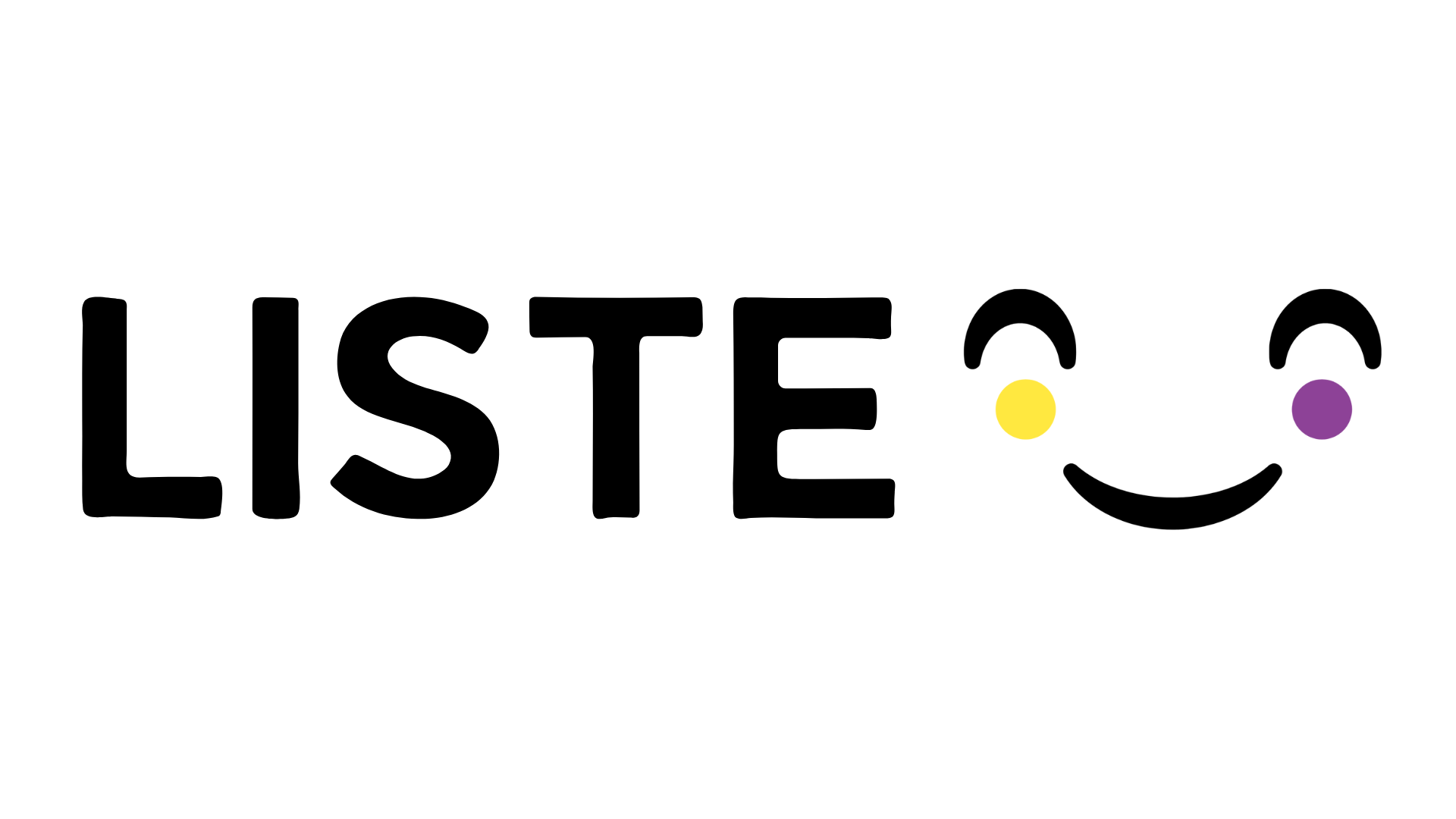
Liste Nakanisi Lisusu Les bons souvenirs 2019-2024 2025